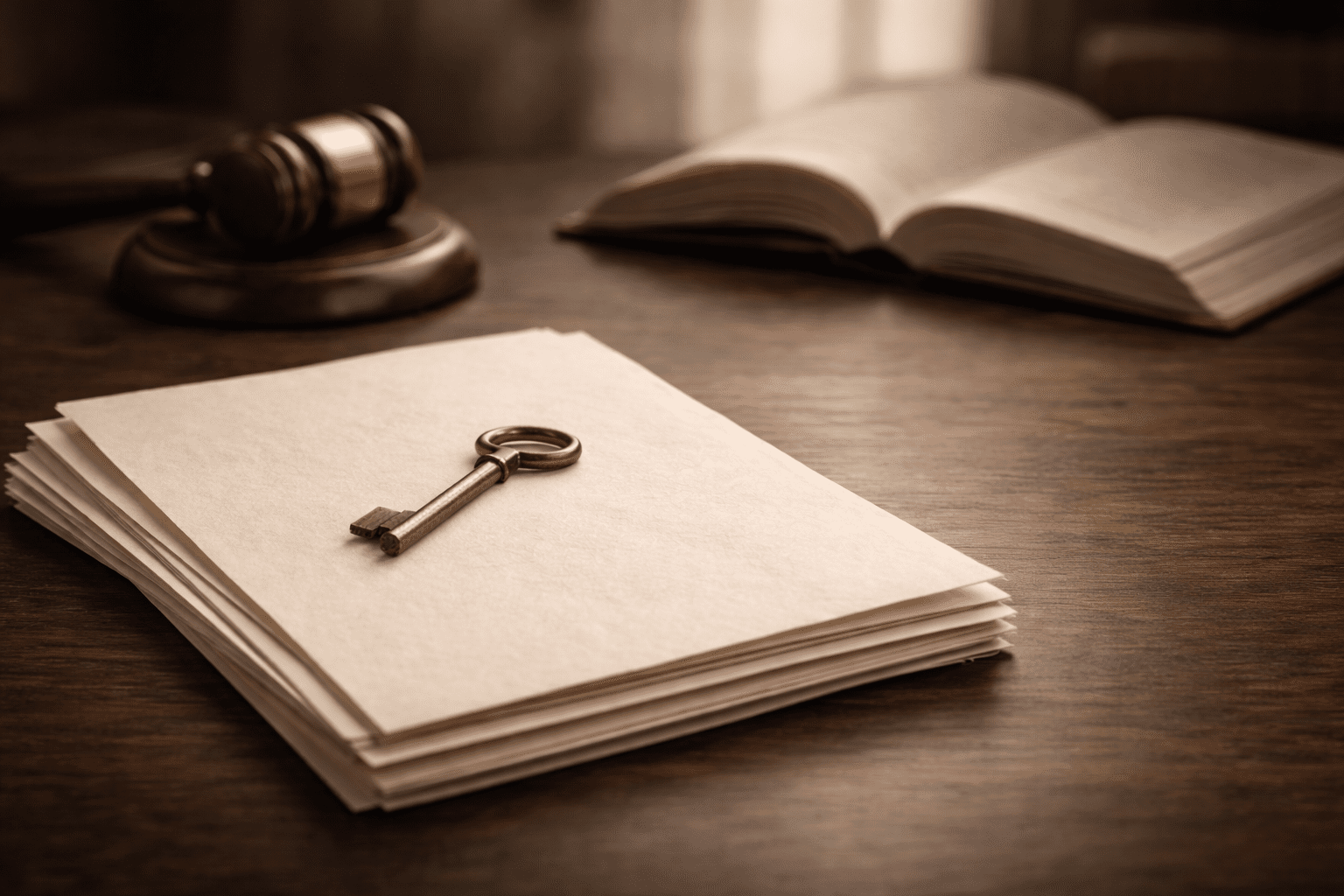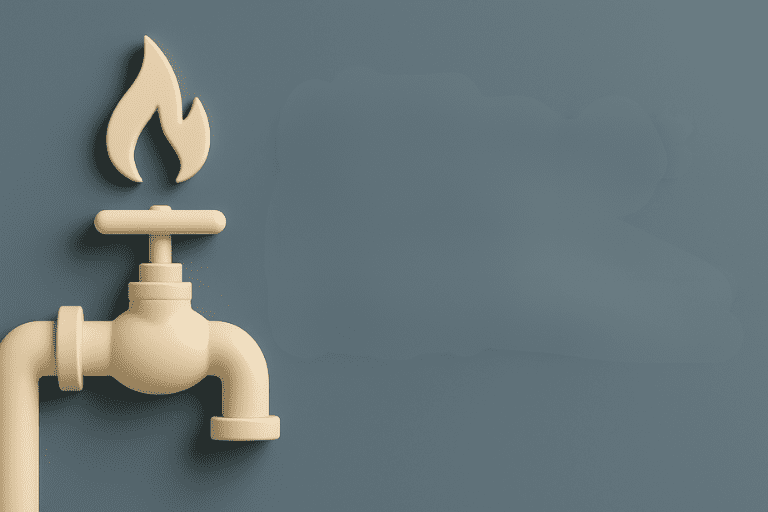Auteur/autrice : contact@thatfw.com
Approvisionnement en gaz : la grande libéralisation ?
Article rédigé par Gilles Robert-Nicoud, publié le 10 novembre 2025.
Le 19 septembre 2025, le Conseil fédéral a mis en consultation un nouveau projet de loi fédérale sur l’approvisionnement en gaz (LApGaz) qui tient compte des critiques émises à l’encontre du premier projet. Il faut rappeler que la ComCo a ouvert le marché du gaz sur le principe en juin 2020.
La loi prévoit une seule zone d’équilibrage équivalant à la zone de marché suisse, la constitution d’un responsable de la zone de marché indépendant (qui ne sera pas propriétaire du réseau de transport) ainsi qu’une Commission fédérale de l’énergie (EnCom, soit l’actuelle ElCom dont les tâches seront étendues). L’accès au réseau négocié fait place à un accès au réseau régulé sous la surveillance de l’EnCom.
Tout consommateur final, quel que soit le volume de consommation, aura le libre choix du fournisseur. Les tarifs d’utilisation du réseau seront basés sur les coûts imputables augmentés d’un bénéfice adéquat (WACC).
Compte tenu des objectifs climatiques de la Suisse, les plans de développement du réseau doivent avant tout être axés sur la décarbonation, ce qui pourrait entraîner la désaffectation de réseaux au profit surtout du chauffage à distance (CAD). Ces coûts (amortissements extraordinaires et coûts de démantèlement) sont à la charge des consommateurs finaux. Le Conseil fédéral suggère une attention particulière en matière d’information des consommateurs, de coordination avec le développement du CAD et de répartition des coûts sur un nombre raisonnable de clients. Le risque est en effet que les coûts de démantèlement soient à la charge des consommateurs qui ne bénéficient pas d’autre option immédiate que l’approvisionnement en gaz.
La contradiction possible est de donner simultanément aux consommateurs finaux le choix de leur fournisseur de gaz (alors que les réseaux seront progressivement désaffectés) et de les maintenir dans un monopole du CAD, qui n’est pas régulé et du seul ressort du Surveillant des prix. La Confédération ne dispose en effet que de peu de compétences dans le domaine des réseaux de chaleur. La LApGaz devrait donc idéalement s’accompagner d’une régulation des réseaux thermiques, qui n’est pas à l’ordre du jour.
La mise sous scellés – Généralités et le cas du smartphone
Un résumé établi par Alexandre Reymond, avocat au barreau
Le séquestre et la perquisition de documents, d’un ordinateur ou d’un téléphone sont courants dans une procédure pénale. Le téléphone portable étant une immense source de renseignements, les autorités pénales (généralement le ministère public) décident souvent de le saisir et de le perquisitionner. Le résultat de cette perquisition se retrouvera dans le dossier d’instruction et sera accessibles à toutes les parties, tels que l’ensemble des prévenus et des plaignants ; il pourra également être versé dans d’autres dossiers portants sur d’autres enquêtes. Le prévenu, ou tout ayant droit, peut cependant préserver certains secrets par la procédure de scellés, à certaines conditions. La jurisprudence du Tribunal fédéral nous renseigne sur les obligations procédurales de celui qui demande les scellés et la portée des motifs qui peuvent être invoqués.
I. La procédure de mise sous scellés
La mise sous scellés vise à soustraire au ministère public des documents lorsqu’un motif justifie de les conserver secret. Le détenteur de documents ou objets saisis par les enquêteurs dispose d’un délai de trois jours pour requérir la mise sous scellés. L’autorité pénale dispose ensuite d’un délai de vingt jours pour saisir le juge (généralement le tribunal des mesures de contrainte) et demander la levée des scellés. Le juge statue rapidement et impartit à celui qui a demandé les scellés un unique délai de dix jours pour se déterminer sur la levée des scellés. Le juge peut s’adjoindre le concours d’un expert pour examiner les documents, les enregistrements ou les objets sous scellés.
Celui qui demande la mise sous scellés des documents ou des objets doit rendre vraisemblable qu’il dispose d’un motif pour demander le séquestre. L’autorité pénale doit apposer les scellés immédiatement. Elle n’a pas le droit de faire une copie des documents, de déverrouiller le téléphone ou de faire une copie miroir. Si une copie ou le déverrouillage est nécessaire, c’est le tribunal qui doit y procéder, éventuellement en mandatant une entité spécialisée. Le Tribunal fédéral a exclu que cette tâche soit effectuée par l’autorité d’enquête (ATF 148 IV 221).
Les détenteurs d’objets et de documents saisis qui s’opposent à leur perquisition doivent exposer de manière circonstanciée les motifs invoqués au plus tard lors de la procédure judiciaire de levée des scellés, pour autant qu’une demande de mise sous scellés conforme à la forme et au délai ait été déposée et qu’une demande de levée des scellés ait été présentée.
En principe, le ministère public ne peut pas rejeter la demande de mise sous scellés ; il doit apposer les scellés et, le cas échéant, requérir la levée de ceux-ci auprès du juge compétent. Le Tribunal fédéral admet cependant que le ministère public puisse rejeter la demande de scellés lorsqu’elle est manifestement abusive, mal fondée ou tardive (TF, arrêt 7B_313/2024 du 24 septembre 2024).
Le risque que le ministère public rejette la demande de scellés impose à celui qui les sollicite d’expliquer immédiatement pour quel motif il en fait la demande et qu’il démontre que sa demande n’est pas tardive. Le cas échéant, il pourra compléter sa demande lorsque le juge lui donnera l’occasion de se déterminer sur la levée des scellés (art. 248a al. 3 CPP).
Les détenteurs qui demandent la mise sous scellés doivent assister le tribunal des mesures de contrainte dans l’examen et le tri des documents. Il doit démontrer l’existence d’un secret et de l’intérêt qui prévaudrait au maintien de ce secret en désignant les documents en question. Cela est d’autant plus vrai que le juge chargé de lever les scellés ne connaît pas les détails de l’enquête et que le ministère public ne peut pas encore examiner les dossiers scellés. Les détenteurs concernés doivent également désigner les objets qui, à leur avis, sont soumis au secret ou qui n’ont manifestement aucun lien avec l’enquête pénale afin de permettre au tribunal de séparer les documents soumis à un secret des autres documents. Cela vaut en particulier lorsqu’ils ont demandé la mise sous scellés de documents ou de fichiers très volumineux ou complexes (ATF 138 IV 225).
En ce qui concerne un smartphone ou un ordinateur, il est nécessaire d’indiquer au juge où et comment sont enregistrés les documents soumis à un secret ou qui relèvent de la sphère privée. Afin de rendre sa décision, le juge examine toutes les pièces et les enregistrements qui font l’objet de la mise sous scellés. Il peut cependant recourir à un expert. Cela est particulièrement indiqué pour assister le juge dans le tri du contenu d’un téléphone.
La décision rendue par le tribunal des mesures de contrainte est définitive (art. 248a al. 4 CPP). Un éventuel recours peut cependant être exercé au Tribunal fédéral pour autant que le recourant démontre l’existence d’un préjudice irréparable.
II. Les motifs du placement sous scellés
Depuis la modification du code de procédure pénale entrée en vigueur en 2024, les motifs qui peuvent être invoqués pour demander le placement sous scellés sont exhaustivement cités par la loi. Les scellés peuvent être demandés pour :
- les documents concernant les contacts entre le prévenu et son défenseur ;
- les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale ;
- les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat ;
- les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP ; ces personnes sont essentiellement les personnes soumises à un secret de fonction et à un secret professionnel ou qui relèvent de la protection des sources des professionnels des médias.
Le secret professionnel est notamment applicable aux ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sage-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires.
Il est important de noter que d’autres secrets, tels que les secrets d’affaires et le secret bancaire ne permettent pas de demander la mise sous scellés (TF, 7B_950/2024 du 15 novembre 2024). Lorsqu’un motif de placement sous scellés est invoqué de manière vraisemblable, la légalité de la perquisition peut également être contestée, mais uniquement à titre accessoire (TF, 7B_950/2024 du 15 novembre 2024).
Il est fréquent que le ministère public saisisse un téléphone et ordonne sa perquisition. Dans ce cas, l’ayant droit peut invoquer les motifs précités, par exemple si son téléphone portable contient des documents médicaux ou de la correspondance avec son avocat. En ce qui concerne le téléphone, il pourra généralement invoquer le secret de ses documents personnels et de sa correspondance. Ce motif vise la protection de la sphère privée, garantie par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Le Tribunal fédéral admet qu’il est notoire que les smartphones à usage privé contiennent généralement une multitude de données sensibles qui touchent à la sphère intime de leur propriétaire et que l’on peut donc supposer sans autre que la perquisition (complète) de smartphones à usage privé porte atteinte aux notes et correspondances personnelles (TF, 7B_145/2025 du 25 mars 2025).
Toutefois, contrairement aux autres motifs permettant la mise sous scellés, la protection de la sphère privée n’est pas absolue et dépend d’une pesée des intérêts entre l’intérêt à la protection de la personnalité et l’intérêt à la poursuite pénale. La partie qui demande les scellés doit donc impérativement démontrer que son intérêt à la protection de sa personnalité pourrait l’emporter sur l’intérêt à la poursuite pénale. Dans tous les cas, le Tribunal fédéral considère que la référence générale à la correspondance privée ou aux photos ne suffit pas (TF, 7B_145/2025 du 25 mars 2025).
Le devoir de collaborer au tri ne signifie pas que le prévenu aurait l’obligation de transmettre ses codes d’accès et ses mots de passe.
III. Conclusions
Celui qui fait face à la saisie et à la perquisition de son téléphone n’est pas démuni pour protéger ses droits fondamentaux et le respect de certains secrets. Outre le fait que toutes les mesures de contrainte doivent respecter des principes fondamentaux tels que la proportionnalité de la mesure et l’existence de soupçons suffisants (art. 197 CPP), le détenteur peut invoquer l’existence d’un secret protégé par la loi ainsi que le respect de sa vie privée.
Celui qui demande la mise sous scellés de documents ou d’un smartphone doit veiller à formuler sa demande dans un délai de trois jours. Si le respect de ce délai risque d’être litigieux, il devrait également veiller à démontrer pourquoi sa demande n’est pas tardive.
Ensuite, celui qui formule cette demande doit également indiquer quel(s) motif(s) il invoque. À cette occasion il doit aussi préciser sur quels documents ces motifs s’appliquent. Lorsqu’il invoque le respect de la sphère privée, il doit indiquer pourquoi la préservation de son intérêt privé au secret doit l’emporter sur l’intérêt à la poursuite pénale.
Finalement, si le ministère public demande la levée des scellés, le détenteur doit collaborer au tri des documents auquel doit se livrer le juge.
Il va de soi que l’assistance d’un avocat dans cette procédure technique est recommandée et augmente les chances de soustraire à l’autorité pénale les documents protégés par un secret professionnel ou qui relèvent de la sphère privée ou intime.
Equilibre femmes-hommes au sein des conseils d’administration des sociétés cotées au Luxembourg – Fixation d’un objectif quantitatif
Auteur : Céline LELIEVRE
La directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022, relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées[1], a introduit un objectif quantitatif en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration des sociétés cotées. Le projet de loi tendant à la transposition de ce texte a été déposé le 28 mars 2025 devant la Chambre des Députés[2].
Le projet prévoit que les sociétés, dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres et ayant leur siège social au Luxembourg, devront veiller à ce que, au plus tard le 30 juin 2026, les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 33 % de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs.
Si la détermination du nombre de postes d’administrateurs nécessaire pour atteindre cet objectif devait faire débat, le projet prévoit que ce nombre correspondra au plus proche de 33 %, sans dépasser 49 %. Par exemple, si le conseil d’administration compte 5 personnes, 2 personnes devront être du sexe sous-représenté, soit 40 % du conseil.
Le texte prévoit également que les sociétés concernées sélectionneront les candidats sur la base d’une appréciation comparative des qualifications, selon des critères prédéfinis. Le texte précise :
« Pour choisir entre des candidats qui possèdent des qualifications égales quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, la priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté, à moins que, dans des cas exceptionnels, des motifs ayant, sur le plan juridique, une importance supérieure, tels que la poursuite d’autres politiques en matière de diversité, invoqués dans le cadre d’une appréciation objective qui tient compte de la situation particulière d’un candidat de l’autre sexe et qui est fondée sur des critères non discriminatoires, ne fassent pencher la balance en faveur du candidat de l’autre sexe. »
Ainsi, si un candidat non retenu du sexe sous-représenté établit, devant une juridiction, qu’il possédait des qualifications équivalentes à celles de la personne sélectionnée, la charge de la preuve incombera à la société, qui devra démontrer l’absence de discrimination.
Ne sont concernées que les grandes sociétés cotées, à l’exclusion des PME, définies comme des entreprises occupant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le bilan annuel total n’excède pas 43 millions d’euros[3].
L’exposé des motifs ajoute que l’augmentation de la représentation des femmes dans les conseils pourrait avoir un « spill-over effect », encourageant leur présence à d’autres niveaux hiérarchiques et influençant positivement les écarts d’emploi et de rémunération entre les sexes[4].
Selon le projet, l’importance économique et la forte visibilité de ces sociétés rendront l’adoption de mesures de promotion de l’égalité particulièrement efficace.
Références
- Directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes.
Texte officiel
↩ - Projet de loi luxembourgeois n°8372, déposé le 28 mars 2025 devant la Chambre des Députés.
www.chd.lu
↩ - Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (PME).
↩ - Analyse d’impact accompagnant la proposition de directive COM(2021) 930 final de la Commission européenne.
↩
L’absentéisme chronique
L’absentéisme chronique, état des lieux avec Céline Lelièvre
Quelle est la protection du salarié en incapacité sur une longue période ? Quels sont alors les droits et les obligations de l’employeur ? A condition que les obligations d’information à charge du salarié soient respectées, y compris pendant les prolongations de la maladie, l’employeur n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail pendant une période de 26 semaines à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail, le salarié étant protégé, pendant cette période de 26 semaines.
En premier lieu, il importe de relever que la protection contre le licenciement est fixée pour une période de 26 semaines et que toute interruption de ce délai, que ce soit par un retour à l’activité professionnelle ou un congé de récréation, fait courrier une nouvelle période de protection de 26 semaines. Pour autant, le dépassement de ce seuil de 26 semaines n’autorise, pas de facto, l’employeur à mettre un terme à la relation de travail. Dès lors, que faire lorsqu’un salarié est en incapacité sans interruption pendant une période dépassant ce seuil de 26 semaines ?
La Cour d’appel de Luxembourg, dans une décision du 13 février 2025[1], vient de rappeler le cadre applicable aux cas d’absentéisme chronique.
Dans cette affaire, un salarié avait été absent sans interruption, pour cause de maladie, pendant six mois. Le salarié, toujours en incapacité alors que la période de 26 semaines qui lui conférait une protection légale contre le licenciement était expirée, avait fait l’objet d’un licenciement avec préavis.
Le salarié avait alors contesté le licenciement intervenu au motif que ses absences étaient dues à une « épuisement psychique professionnel », qu’il se serait plaint à de nombreuses reprises de l’aggravation de ses conditions de travail et que son supérieur hiérarchique avait connaissance de la situation. En outre, le salarié exposait que les absences répétées et prolongées sur six mois avaient été intégralement couvertes par des certificats médicaux, établis en bonne et due forme et délivrés par un psychiatre, en raison d’un burn-out, causé par le stress excessif qui lui était imposé par son ancien employeur, de sorte que son incapacité était en lien causal direct avec l’exécution de son contrat de travail. De son côté, l’employeur avait fait valoir que cette absence prolongée avait nui au bon fonctionnement de l’entreprise.
La Cour a alors rappelé que l’absentéisme chronique était considéré comme un motif légitime de licenciement avec préavis, dès lors que les absences invoquées par l’employeur avaient porté préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise et que l’employeur ne disposait pas d’informations fiables lui permettant de présumer qu’il pourra à l’avenir compter sur la présence et la disponibilité de son salarié. La Cour a encore exposé qu’une absence chronique de six mois dépassait le seuil des risques normaux que l’employeur devait assumer, avant de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence constante, il y avait lieu de présumer qu’une absence continue de six mois portait atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise concernée.
Pour la Cour, cette présomption s’applique quelle que soit la cause des absences, à moins que celles-ci ne soient la conséquence directe d’un accident du travail subi dans l’entreprise ou d’une maladie qu’il aurait contractée auprès de cette dernière en raison de son travail. Il existe donc une limite à cette présomption : l’employeur ne peut licencier un salarié pour absentéisme chronique si c’est l’exécution du contrat de travail qui est la cause de l’incapacité. Mais il appartient alors au salarié, qui conteste son licenciement, d’apporter la preuve que sa maladie chronique, qui a duré plus de 26 semaines, est la conséquence directe d’un accident du travail ou d’une maladie dite professionnelle et de démontrer le lien de causalité entre son incapacité et l’exécution de son contrat de travail.
En l’espèce, la Cour, reprenant l’analyse des premiers juges a retenu que la simple circonstance que les certificats d’incapacité de travail aient été établis par un médecin spécialiste en psychiatrie n’étaient pas de nature à établir un lien de causalité entre l’origine de l’incapacité du salarié et son activité professionnelle, une telle affection psychiatrique pouvant avoir de multiples causes personnelles, familiales ou sociales, étrangères aux conditions de travail du salarié licencié.
Il convient de relever que dans cette affaire, l’employeur avait contesté tout lien entre l’absence prolongée et les conditions de travail du salarié, démontrant que le salarié s’en était « toujours strictement tenu aux horaires de travail contractuellement prévus » et n’avait presté que « très rarement » des heures supplémentaires.
Alors que le salarié n’a pu établir de lien direct entre la cause de son absentéisme et l’exécution de son contrat de travail, la Cour a retenu que son absence continue était présumée porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise et que le fait que, pendant cette période prolongée d’absence, l’employeur n’ait pas disposé d’informations fiables qui auraient pu lui permettre de présumer qu’il aurait pu, à un moment ou à un autre, compter dorénavant sur la présence et la disponibilité de son salarié, avait encore appuyé ladite présomption.
Le licenciement prononcé a donc été déclaré valable.
[1] Arrêt n°19/25 – III- TRAV – numéro de rôle CAL-2023-00600
Maître Céline Lelièvre rejoint notre étude en qualité d’associée
« Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de Maître Céline LELIEVRE, en qualité d’associée, au sein de notre étude.
Son arrivée s’inscrit dans notre volonté constante d’élargir notre champ de compétences et marque une nouvelle étape dans notre engagement à offrir à nos clients une expertise juridique de haute qualité et un accompagnement sur mesure
Me Lelièvre a fait ses études en France (Nancy). Elle a ensuite rejoint l’université de Luxembourg avant de passer ses examens du barreau. Avocat à la Cour, inscrite au barreau de Luxembourg depuis 2001, Maître Lelièvre est également inscrite à l’Ordre des Avocats Vaudois depuis 2015.
Grâce à son expérience, Maître Lelièvre saura conseiller et défendre nos clients avec rigueur, professionnalisme et engagement.
Son arrivée renforce particulièrement notre activité en droit des sociétés, en droit du travail (y compris en ce qui concerne les questions relatives au cadre de coordination des régimes d’assurances sociale), dans le domaine des marchés publics et dans toute la matière contractuelle en général. Elle accompagne et conseille nos clients non seulement dans le cadre de leur activité (contrats, conditions générales, appels d’offre, acquisition, transformation, recouvrement, etc.) mais également pour toutes les questions liées à la gestion de leurs collaborateurs (contrat de travail, modifications, permis, fin de relation de travail, etc.).
Me Lelièvre met ses compétences au service des entreprises, des institutions et des particuliers, en les accompagnant aussi bien en conseil qu’en contentieux.
Avec une approche pragmatique et une écoute attentive, formée aux modes alternatifs de gestion des conflits comme la médiation, le droit collaboratif ou la négociation raisonnée, Maître Lelièvre sait proposer des stratégies adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
Avant de rejoindre notre étude, Me Lelièvre a démarré son activité au Luxembourg où elle exerce d’ailleurs toujours. En 2015, elle a rejoint un cabinet actif en droit des sociétés à Lausanne.
Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes convaincus que son dynamisme et son expertise seront des atouts précieux pour notre équipe et nos clients. »
Le Code de procédure civile suisse révisé
Secret professionnel étendu aux juristes d’entreprise
Etat des lieux avec Anthony Braham
Une réforme majeure du Code de procédure civile suisse
Depuis le 1er janvier 2025, une révision du Code de procédure civile (CPC) accorde aux juristes d’entreprise le même niveau de protection du secret professionnel que les avocats externes. Une avancée alignée avec les standards internationaux et attendue par le monde juridique suisse.
Le secret professionnel des avocats en Suisse
Définition et portée
En Suisse, les avocats sont tenus à une stricte confidentialité concernant leurs échanges avec les clients. Ce secret couvre tous les supports et est protégé par des sanctions civiles, pénales et professionnelles en cas de manquement.
Droit de refuser de témoigner
Les avocats peuvent refuser de témoigner ou de produire des documents couverts par ce secret professionnel devant les tribunaux.
Pourquoi les juristes d’entreprise n’étaient pas concernés
Les avocats suisses doivent être inscrits au registre cantonal pour exercer. En intégrant une entreprise, ils doivent quitter le barreau, perdant ainsi les protections associées. Contrairement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où les avocats internes conservent ce droit, la Suisse faisait figure d’exception.
Comparaison avec d’autres juridictions
Dans les pays de common law comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, le secret s’applique à tous les avocats. Dans les pays de droit civil (France, Belgique, Allemagne…), les protections existent mais varient selon les conditions d’exercice.
Les enjeux pour les entreprises suisses
Sans protection du secret pour les juristes d’entreprise, les sociétés suisses étaient exposées dans les litiges transfrontaliers, notamment face aux exigences de la discovery américaine. Cela les plaçait en position désavantageuse par rapport à leurs homologues étrangers.
Article 167a CPC : nouvelles conditions de protection
Critères à respecter
Le nouvel article 167a permet à une entreprise de refuser la production de documents si :
- Elle est enregistrée au registre du commerce suisse ou équivalent étranger ;
- Le responsable juridique possède un brevet d’avocat cantonal ou l’équivalent étranger ;
- L’activité est assimilable à une mission typique d’avocat.
Protection élargie mais limitée
La protection s’étend aux non-avocats du service juridique, si celui-ci est dirigé par un avocat. Toutefois, seules les tâches purement juridiques sont protégées — les activités politiques, sociales ou commerciales ne le sont pas.
Cas limites et interprétations possibles
Des débats sont attendus, notamment dans le cas d’enquêtes de conformité internes. L’organisation hiérarchique pourrait influencer l’évaluation juridique du caractère confidentiel ou non des échanges.
Enjeux d’application internationale
Bien que l’introduction de l’article 167a soit une étape positive, son applicabilité dans des contextes internationaux, en particulier dans les litiges américains, reste un sujet de débat. Les règles relatives à la preuve et à la divulgation dans les tribunaux fédéraux et d’État des États-Unis diffèrent considérablement de celles de la Suisse. Toutefois, les tribunaux américains peuvent reconnaître le « brevet » suisse (autorisation d’exercer) comme équivalent à la licence d’un avocat américain, étendant ainsi le secret professionnel aux « juristes » travaillant sous la supervision d’un « avocat breveté » par analogie avec « l’agent ou le subordonné » d’un avocat américain.
Conclusion
Cette révision représente une avancée longtemps attendue dans la protection des communications des juristes d’entreprise en Suisse. Bien que l’application pratique de l’article 167a dépende de l’interprétation judiciaire et de la jurisprudence, il s’agit d’un développement crucial pour les entreprises suisses, leur offrant une protection indispensable dans un environnement juridique de plus en plus mondialisé.
Nouveautés dans le droit international des successions
Etat des lieux avec Anthony Braham.
A quel droit peut-on soumettre son testament en Suisse ?
Comment les héritiers peuvent-ils transférer les biens, s’ils se trouvent à l’étranger ?
Quid si le testament est soumis à un droit étranger, mais que le testateur est domicilié en Suisse à son décès ?
Autant de questions que loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) est censée résoudre. Son chapitre relatif aux successions a été modifié et approuvé le 22 décembre 2023 par notre Parlement.
La modification a deux buts :
- moderniser le droit suisse des successions internationales, notamment en codifiant certaines pratiques jurisprudentielles ;
- l’harmoniser avec l’évolution du droit à l’étranger, notamment suite à l’adoption du Règlement UE n° 650/2012, applicable depuis 2015, et qui a introduit le certificat d’héritier européen.
La modification a aussi pour vocation d’augmenter l’autonomie des parties et de réduire le risque de conflits de compétence entre les autorités suisses et étrangères, que ce soit au stade de la dévolution et de la délivrance du certificat d’héritier (probate process, en droit anglo-saxon), ou au moment du partage, et des différentes actions en justice contestant le testament ou ses dispositions.
Un des sujets débattus au Parlement concerne le choix de la loi applicable (professio juris).
Le choix du droit applicable
Actuellement, une personne vivant en Suisse et ayant la double nationalité suisse et étrangère, ne peut pas soumettre son testament à un droit étranger. Le droit suisse s’applique nécessairement.
Or il arrive fréquemment que des expatriés, en Suisse depuis de nombreuses années, acquièrent la nationalité Suisse. L’une des conséquences de la règle actuelle est que, si leur testament est soumis au droit étranger ou contient des références à des concepts de droit étranger, il pourrait être partiellement ou totalement invalidé.
On pourra désormais choisir son droit, mais dans certaines limites
À l’origine, l’avant-projet du Conseil Fédéral avait supprimé toute restriction, laissant une liberté complète au testateur ou à la testatrice.
Mais lorsque le Parlement a examiné le projet de loi à l’automne 2023, il a considéré que la notion d’héritier réservataire faisait partie des principaux fondamentaux du droit suisse des successions.
Ainsi, la version finale, approuvée le 22 décembre 2023, bien que conservant le droit pour les ressortissants étrangers qui sont également de nationalité suisse de choisir un droit étranger, a introduit une limitation : le testament soumis au droit étranger ne pourra contenir aucune exception aux règles sur les héritiers réservataires.
Les héritiers réservataires en droit suisse sont actuellement les descendants d’une personne (ses enfants) et son conjoint survivant. La part réservataire dépend de la composition de la famille, mais peut atteindre 50 % de l’ensemble de la succession.
La nouvelle loi permettra néanmoins l’utilisation de concepts de droit étranger, qui sont actuellement impossibles, comme le testamentary trust, institution chère aux anglo-saxons pour ses avantages en termes d’indépendance du patrimoine et de gestion par des tiers.
Entrée en vigueur prévue pour 2025
Le Conseil fédéral n’a pas encore, à la date de rédaction de cet article, fixé l’entrée en vigueur des nouveaux articles 51, 58, et 86 à 96 de la LDIP.
Selon les informations disponibles, elle est prévue probablement pour 2025. Cet article sera mis à jour dès que la date sera connue.
Notion de domicile en droit fiscal
L’actualité nous rappelle fréquemment que le droit fiscal connaît sa propre définition du domicile.
Etat des lieux avec Christian Chillà.
D’après l’article 3 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable, elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative ; elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative.
La personne qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
La notion de domicile fiscal revêt donc une importance particulière. Si ce domicile se trouve en Suisse, la personne est alors en principe imposée de manière illimitée sur tous ses revenus et, au niveau cantonal, sur sa fortune, indépendamment de la source des revenus ou du lieu de situation de la fortune.
Il s’agit d’une imposition mondiale et globale.
Cette imposition est toutefois limitée, au niveau international, par des Conventions de double imposition et, au niveau cantonal, par les règles de partage intercantonal et en particulier par l’art. 6 LIFD et le principe constitutionnel de l’interdiction de la double imposition intercantonale consacré à l’art. 127 al. 3 Cst. féd.
Initialement, la loi fiscale renvoyait à la notion de domicile civil pour déterminer le domicile au sens fiscal. Depuis l’introduction de la LIFD, cela n’est plus le cas. Cependant, en principe, le domicile fiscal correspond au domicile civil.
Le domicile fiscal est une notion autonome et indépendante de celle de droit civil. Il est donc possible d’avoir un domicile civil à un endroit tout en ayant un domicile fiscal à un autre endroit.
Le domicile fiscal repose sur deux éléments :
– L’un objectif (le séjour) : à savoir la présence physique d’une personne à un endroit déterminé
– l’autre subjectif (la volonté de faire de ce lieu le centre de ses intérêts vitaux).
La résidence est un élément de fait. L’intention de s’établir est l’élément subjectif du domicile. S’il n’est pas indispensable que la personne ait l’intention de s’établir en un endroit définitivement, il faut cependant qu’elle ait la volonté d’y séjourner. Toutefois, ce qui importe n’est pas la volonté intime de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette intention. Autrement dit, le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette personne.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la double imposition (cf. art. 127 al. 3 Cst.), le domicile fiscal (principal) d’une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir durablement (cf. aussi, pour le domicile fiscal cantonal, art. 3 al. 2 LHID), soit le lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels. Dans un tel cas, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins.
Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites.
Dans le cas des pendulaires, qui travaillent dans un canton mais qui rentrent tous les jours dans leur canton de résidence, ce dernier est le canton de domicile fiscal.
La détermination du domicile fiscal implique d’apprécier des éléments de fait relevant de la sphère intime des contribuables, soit de leur volonté d’établir en un lieu le centre de leurs intérêts personnels. Cette appréciation ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d’un faisceau d’indices ; elle nécessite une appréciation détaillée de l’ensemble des relations professionnelles, familiales et sociales. Dans ce contexte, le domicile politique ne joue pas un rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal.
Pour le contribuable marié, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail ; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille. Il en va de même pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) et ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et pendant son temps libre (on parle dans ce cas de « Wochenaufenthalter« ). En principe, les époux disposent d’un domicile fiscal commun. Toutefois, d’un point de vue fiscal, chaque époux peut disposer d’un domicile principal distinct.
Cela est notamment le cas lorsque le contribuable exerce une activité lucrative dépendante dans une fonction dirigeante. Dans cette situation, il faut présumer que le centre de ses intérêts se trouve au lieu de son travail. Cette présomption peut être renversée en prouvant l’existence de rapports particulièrement intenses avec le lieu de résidence de la famille ou l’absence de fonction dirigeante. La jurisprudence a posé des critères pour déterminer dans quelles circonstances on se trouve en présence d’une fonction dirigeante. Si la fonction dirigeante est reconnue, l’imposition conjointe des époux demeure et il faudra alors procéder à une répartition intercantonale et/ou internationale des facteurs imposables de la famille.
Ces principes s’appliquent également au contribuable célibataire, séparé ou veuf, car la jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs de celui-ci font partie de la famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner comme domicile fiscal non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents sont généralement plus distants que ceux entre époux. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l’âge du contribuable ont une importance particulière. Ces règles ne trouvent application que mutatis mutandis lorsque le contribuable célibataire, séparé ou veuf met fin par étape à son activité lucrative, parce qu’il entend prendre sa retraite. En pareille hypothèse, il convient de revenir à la règle générale selon laquelle c’est au moyen de l’ensemble des circonstances objectives qu’il convient de déterminer le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels et donc son domicile fiscal.
Que le contribuable soit célibataire ou marié, le risque que plusieurs autorités fiscales (cantonales ou internationales) revendiquent de manière concurrente leur pouvoir d’assujettir une personne à l’impôt de leur juridiction fiscale existe et mérite une analyse détaillée d’un spécialiste.